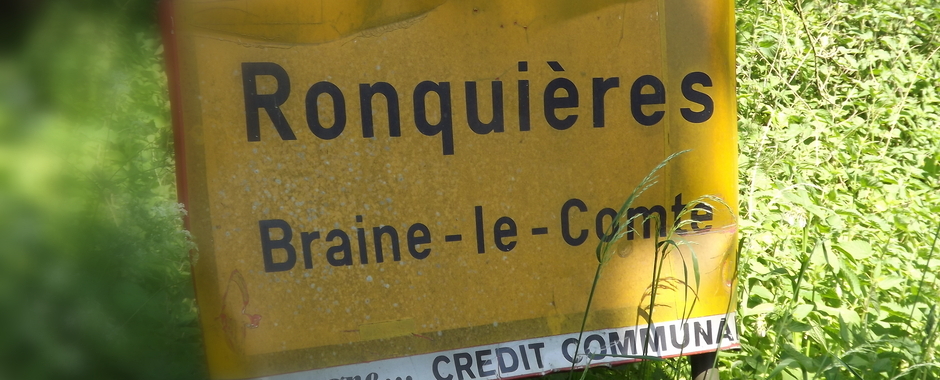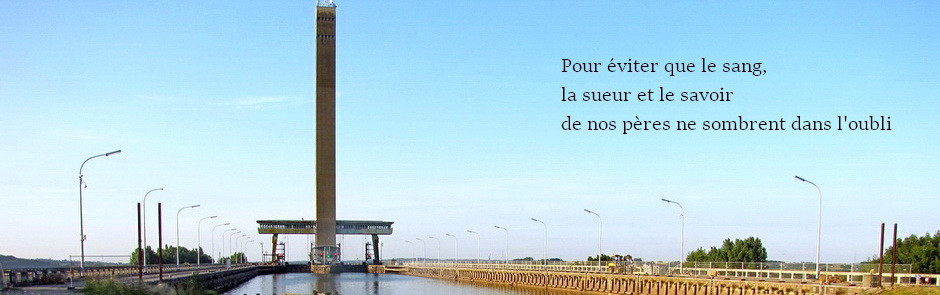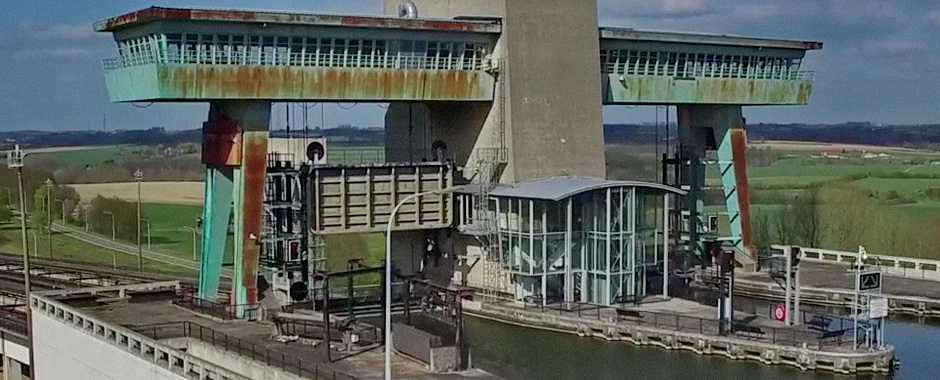![]()
- Les curés de Ronquières
- Les pasteurs de Ronquières
- Les chapelains et vicaires de Ronquières
- L’église paroissiale de Ronquières
- Le mur d’enceinte de l’église
- Les cloches
- La cloche de la communauté.
- La petite cloche
- Le presbytère ou maison curiale
- Les marcularis ou marguilliers
- Le drame calviniste